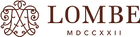À mourir pour
À l'aube du XVIIIe siècle, dans une histoire de persécution religieuse, d'espionnage industriel et d'assassinat, la famille Lombe a fondé l'industrie britannique de la soie.

Carte de visite d'un marchand de soie londonien (début du XVIIIe siècle)

Moulin de Lombe par Henry Lark Pratt (1850)
Le développement de l'industrie de la soie anglaise doit beaucoup aux compétences de tissage spécialisées introduites par les immigrants huguenots qui avaient fui les persécutions religieuses en France.
En 1685, le roi catholique Louis XIV promulgua l'édit de Fontainebleau, qui interdisait la pratique du protestantisme. Les offices huguenots furent interdits et leurs églises incendiées, mais il était illégal de quitter le pays. Ceux qui tentaient de s'y opposer risquaient l'exécution ou une vie de travaux forcés comme galériens.

Le massacre des huguenots à Paris le jour de la Saint-Barthélemy
Malgré ces risques, environ 200 000 protestants français – majoritairement calvinistes – s'enfuirent à l'étranger, se cachant dans des bottes de paille, des tonneaux de bière vides ou des cuves de vin. Entre 50 000 et 80 000 d'entre eux s'installèrent à Londres, notamment dans les quartiers de Soho et de Spitalfields.
Nombre des huguenots qui s'installèrent à Spitalfields venaient de Lyon, haut lieu de l'industrie française de la soie. Ils y établirent des entreprises de tissage de soie, utilisant des métiers à tisser manuels pour tisser des tissus à partir d'organsine (fil de soie filé) importé d'Italie.

Tissage de la soie à Spitalfields : Hogarth (1747)
L'Italie utilisait le filage mécanique depuis le début du XVIIe siècle, une description ayant été publiée pour la première fois par Vittorio Zonca. Léonard de Vinci avait déjà esquissé un modèle similaire, mais la version de Zonca était plus complète et devint le modèle de l'industrie.
L'organsine, ou soie jetée , était produite principalement dans les domaines de Savoie, décrite par un observateur comme étant fabriquée « au moyen d'une machine grande et curieuse, dont l'équivalent n'existait pas ailleurs ».

Machine à filer : Vittorio Zonca (1607)
Les Italiens détenaient un quasi-monopole sur la production d'organzine et, pendant longtemps, ont réussi à garder leur artisanat secret grâce à l'imposition de lois strictes.
Thomas Lombe a déclaré dans une lettre au Parlement :
"La punition prescrite par l'une de leurs lois, pour ceux qui découvrent, ou tentent de découvrir, quoi que ce soit relatif à cet art, est la mort, avec la confiscation de tous leurs biens, et d'être ensuite peint sur l'extérieur des murs de la prison, pendu à la potence par un pied, avec une inscription indiquant le nom et le crime de la personne ; à conserver là comme une marque perpétuelle d'infamie."

Une machine à filer reconstituée du XVIIe siècle au Filatoio Rosso di Caraglio (filature rouge de Caraglio) dans le Piémont, fondée en 1676
Malgré le danger inhérent, les frères Lombe étaient convaincus que si le procédé de filage secret pouvait être importé en Angleterre, il rapporterait une fortune grâce au fil de haute qualité qu'il produirait.
Jean se rendit donc en Italie en 1715 pour se procurer la production d'organsine piémontaise - le fil de soie doublement retors le plus fin, apprécié des tisserands français - et, déguisé en paysan, obtint un emploi dans l'une des nombreuses usines établies depuis longtemps dans la région du Piémont à l'époque.

John Lombe dans le Piémont (1715)
Croyant John sans abri, les propriétaires l'autorisèrent à dormir à même le sol de leur immeuble, d'où il s'introduisait furtivement dans les ateliers la nuit et dessinait minutieusement les schémas des moteurs à la lueur des bougies. Cependant, alors qu'il menait ses investigations, des rumeurs commencèrent à circuler selon lesquelles il fouillait dans les secrets de la filature de soie, et il fut contraint de fuir pour sauver sa vie.
Il réussit à embarquer sur un navire marchand à destination de l'Angleterre, emportant avec lui un coffre de voyage contenant les notes et les dessins qu'il avait compilés, ainsi que les modèles originaux et papier des pièces de machines qu'il avait réussi à obtenir. Un brick italien fut envoyé à sa poursuite, mais le navire anglais se révéla heureusement le meilleur navigateur des deux et échappa à la capture.

Le vieux coffre du Piémont illustré en 1860
John, avec son coffre aux trésors , arriva à Londres en 1716 et, après consultation avec son frère, fit rédiger un cahier des charges. Un brevet pour l'« organisation de la soie grège » fut déposé en 1718 et accordé pour quatorze ans.
Thomas Lombe a expliqué :
« La machine possède 97 746 roues, mouvements et pièces individuelles (qui fonctionnent jour et nuit), qui reçoivent tous leur mouvement d'une grande roue hydraulique et sont régis par un seul régulateur. »
Suite au succès de leur demande de brevet, les frères Lombe ont engagé le légendaire George Sorocold, considéré comme le premier ingénieur civil de Grande-Bretagne , et les travaux de construction de leur usine de soie à Derby ont commencé.

Machine à lancer la soie Lombe (1718)
Les activités de Lombe n'avaient pas échappé à l'attention de Victor-Amédée II, duc de Savoie et futur roi de Sicile. Non seulement il interdit l'exportation de soie grège piémontaise vers l'Angleterre, mais, selon la légende, après être devenu roi de Sardaigne en 1720, il ordonna à un assassin de se rendre à Derby pour tuer les frères.
Malheureusement, John Lombe ne vécut pas assez longtemps pour assister à la naissance du moulin de Derby. Il mourut sur place le 16 novembre 1722, à seulement 29 ans, apparemment victime d'un empoisonnement. Une mystérieuse Italienne, récemment arrivée dans la ville, fut interrogée par les autorités locales, mais relâchée faute de preuves.

Victor-Amédée II, roi de Sardaigne (1720-1730)
Après la mort de John, Thomas continua à diriger la filature de soie, qui employait plus de 300 personnes dans les années 1730. À l'expiration de son brevet en 1732, il demanda au Parlement une prolongation. La proposition de Lombe fut rejetée, mais le gouvernement lui accorda 14 000 guinées à condition qu'il dépose un modèle de sa machine à titre de référence à la Tour de Londres.
Il fut anobli par le roi George Ier et devint échevin de Londres et shérif de la ville. Sir Thomas Lombe s'était taillé une place parmi les personnalités les plus respectées du pays. Sa fille Mary épousa James Maitland, 7e comte de Lauderdale, dont les robes de soie sont magnifiquement immortalisées par Sir Joshua Reynolds dans le portrait ci-dessous.

James Maitland, 7e comte de Lauderdale (1750)
Après l'expiration du brevet de Lombe, le modèle d'usine dont il était le pionnier fut copié dans les villes d'Angleterre et, en 1852, plus de 130 000 personnes étaient employées dans l'industrie de la soie anglaise.
Thomas mourut le 2 juin 1739 et le moulin passa entre plusieurs propriétaires, conservant son association avec le commerce de la soie tout au long du XIXe siècle.

Moulin de Lombe par William Caxton Keene (vers 1890)
Après le traité Cobden-Chevalier de 1860, l'industrie anglaise de la soie connut un déclin brutal. L'accord franco-britannique supprima les droits de douane sur les principaux produits d'échange entre les deux pays : le charbon, le fer et les produits industriels en provenance de Grande-Bretagne ; et en provenance de France : le brandy, le vin… et les soieries !
Le tissage de la soie française, notamment à Lyon , avait continué à se développer depuis le départ des huguenots quelque 150 ans plus tôt, tandis que la hausse des coûts de production en Grande-Bretagne rendait l'industrie britannique non compétitive une fois les tarifs supprimés.

Première photographie connue du moulin de Lombe (vers 1900)
L'industrie de la soie anglaise ne s'en est jamais remise et, au tournant du siècle, elle n'était plus que l'ombre de sa taille et de son influence passées. En 1908, l'association de la filature avec la production de soie prit fin lorsque FW Hampshire & Company, une société de chimistes, reprit les lieux pour fabriquer du papier tue-mouches et des médicaments contre la toux.
Cette chute fut aggravée aux premières heures du 5 décembre 1910, lorsqu'un incendie se déclara au moulin à farine voisin des frères Sowter et engloutit rapidement le moulin à soie.

L'incendie du moulin par Alfred John Keene (1910)
Les pompiers de l'arrondissement ont déployé de grands efforts pour sauver la structure, parvenant à préserver l'enveloppe de la tour et les contours des portes d'origine qui menaient autrefois aux cinq étages. Ces éléments sont encore visibles aujourd'hui sur l'escalier de la tour.
Le bâtiment a été reconstruit à la même hauteur, mais avec trois étages au lieu de cinq — une configuration qui perdure encore aujourd'hui.

La tour du moulin de Lombe (2025)
Dans les années 1920, le bâtiment fut acquis par l'Autorité de l'Électricité et transformé en entrepôt, ateliers et cantine pour le personnel. Dissimulé au public par la centrale électrique adjacente, il disparut progressivement de la circulation jusqu'à la démolition de cette dernière en 1970.
Par la suite, le bâtiment a été adapté pour abriter le musée industriel de Derby, qui a officiellement ouvert ses portes le 29 novembre 1974. En 2001, il a été reconnu comme faisant partie du site du patrimoine mondial de l'UNESCO des moulins de la vallée de Derwent.

Les portes du moulin de Lombe (2025)
Les magnifiques grilles en fer forgé, classées Grade I, installées en 1725 par le célèbre forgeron Robert Bakewell, constituent le joyau du moulin. Elles présentent un arrangement complexe de volutes, de motifs végétaux et de guirlandes florales, caractéristiques de l'artisanat géorgien primitif.
Au centre du renversement, un cartouche finement ouvragé porte les initiales entrelacées des fondateurs, John et Thomas Lombe, servant d'expression symbolique de l'unité et de la force familiales.

Le Moulin de Lombe Grotesque (2025)
L'élément le plus insolite des portes est la présence d'un grotesque placé au-dessus des vantaux, faisant office de butée. Symboliquement, ces figures servent d'avertissements – destinés à éloigner les mauvais esprits – et de memento mori , nous rappelant notre mortalité.
En l'honneur des risques, des sacrifices et de l'engagement indéfectible envers l'excellence dont ont fait preuve tous ceux qui sont liés à l'histoire de Lombe, le nom a été relancé et célébré - exactement 300 ans après l'ouverture des portes du moulin - avec une collection de parures incomparables conçues pour créer une garde-robe sur mesure à tomber par terre .